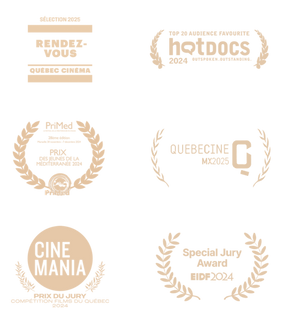L'histoire
Dans le sud de la France, Jawad et Belka, deux jeunes hommes d’origine maghrébine, s’affranchissent à travers leur passion pour les courses camarguaises.
Bien plus qu’un combat traditionnel, cet affrontement, sans mise à mort, entre des hommes et un taureau leur permet de prendre leur place dans l’arène comme dans la société française.
Mais à quel prix ?
« J’ai été éduqué dans la tradition maghrébine, et dans la religion de l’Islam. Mais voilà, moi je suis français d’origine marocaine et pas marocain d’origine française. »
Jawad
« Demain, je sors, je suis une personne quelconque. Et dans l’arène on va te regarder comme si tu es un footballeur, en fait. T’as des gens qui te regardent que toi, qui t’applaudissent. C’est ce que je retrouve en piste que je n’ai pas connu dans la vie. »
Belka
Où voir le film
À propos
Réalisé par Jérémie Battaglia, «Une jeunesse française » explore la quête d’émancipation de jeunes hommes d’origine maghrébine à travers leur passion pour les courses camarguaises. Cette tradition ancestrale et méconnue du sud de la France, où des raseteurs affrontent des taureaux sans mise à mort, offre à ces jeunes une opportunité unique de s’intégrer et de trouver leur place dans la société française.
Le film suit notamment le parcours de Jawad et Belka, deux raseteurs à des moments charnières de leur vie. Jawad, après une blessure majeure, s’interroge sur son avenir dans ce sport exigeant. Belka, quant à lui, marche dans les pas de son père, voyant dans cette discipline une chance de se détourner d’un avenir incertain et de réaliser son rêve de devenir champion de France.
Au-delà des arènes, « Une jeunesse française » offre une immersion intime dans la réalité de ces jeunes Français d’origine maghrébine. À travers leurs témoignages sincères, le documentaire met en lumière les défis qu’ils rencontrent, notamment la lutte contre les préjugés et le racisme, tout en célébrant leur résilience et leur détermination.
Le processus de tournage s’est déroulé sur plusieurs années, de 2018 à 2022, permettant au réalisateur de tisser des liens de confiance avec ses protagonistes et de capturer des moments authentiques de leur quotidien. Le film adopte une approche immersive, participant aux entraînements et aux compétitions, afin de saisir au plus près les défis et les aspirations de Jawad et Belka. Cette proximité permet de révéler la complexité de leur quête d’identité et d’intégration à travers leur passion pour les courses camarguaises.
Les courses camarguaises
Une jeunesse française se déroule dans l’univers méconnu de la course camarguaise, une tradition méridionale unique du sud de la France. À la différence de la corrida espagnole, la course camarguaise ne met pas en scène la mise à mort de l’animal, mais repose sur un affrontement spectaculaire et esthétique entre le raseteur – vêtu entièrement de blanc – et le taureau noir de Camargue. Le but pour les raseteurs : mettre en valeur l’animal en venant le frôler, le «raser», afin de décrocher, dans un temps limité, des attributs placés entre les cornes du taureau. Si le sport récompense les coureurs, c’est pourtant le taureau qui en est l’incontestable star, allant jusqu’à être immortalisé par des statues dans les villages de la région.

Depuis les années 60, ce sport traditionnel attire de plus en plus de jeunes issus de l’immigration. Initialement dominée par les enfants d’immigrants italiens et espagnols, la course camarguaise est aujourd’hui investie par de jeunes hommes d’origine maghrébine qui y trouvent une rare opportunité de reconnaissance et d’intégration sociale. Pourtant, cet univers profondément traditionnel ne se libère pas facilement de ses contradictions : entre admiration pour les raseteurs et racisme latent parfois ouvertement exprimé, la cohabitation demeure fragile.

Mot du réalisateur

J’ai grandi à Marignane, en banlieue de Marseille, aux côtés de nombreux jeunes issus de l’immigration maghrébine. Très tôt, j’ai vu comment le racisme systémique entravait leur parcours, renforçant des préjugés tenaces. Aujourd’hui encore, les jeunes hommes d’origine maghrébine sont trop souvent réduits à des stéréotypes : voyous, radicalisés, incompatibles avec les valeurs françaises alors même qu’ils sont nés et ont grandi ici.
Face à cette stigmatisation, j’ai voulu réaliser un film qui réhumanise ces jeunes. Montrer leur dignité, leur courage, leurs rêves simples et universels.
En Camargue, cette région marquée par de fortes tensions identitaires, j’ai découvert les courses camarguaises. Dans l’arène, face au taureau, de nombreux jeunes hommes issus de la communauté maghrébine se battent symboliquement pour la reconnaissance et l’honneur. Cette métaphore sociale est devenue le cœur du film.
Jawad et Belka, deux jeunes raseteurs, incarnent cette lutte silencieuse : celle de s’imposer dans une société qui tarde encore à pleinement les reconnaître.
Une jeunesse française est un appel à regarder autrement cette autre jeunesse française : avec nuance, humanité et respect.
Contact et informations
Distribution
Guillaume Sapin
Presse
Anne-Lise Kontz